Ce siècle va être l’apogée économique, la population atteint son summum ; au moins 700 personnes, avec une pointe à 1100 vers 1860, comme l’indique le graphique du résumé en tête de ce texte.
A cette époque, les plantations de mûriers sont à leur maximum, chaque terrasse est cultivée, de surcroît le vin, même celui de qualité courante se vend bien. Ces cultures nécessitent beaucoup de main d’œuvre d’appoint, on travaille en famille ; à de rares exceptions près, les propriétés ont de faible superficie, chacun est très attaché à son petit lopin et le cultive amoureusement.
Nous vivions là une forme avancée de démocratie rurale où chacun devait respecter les autres et vivre avec sur un pied d’égalité, toutes opinions confondues.
En 1816, le maire de Chandolas est Joseph-Paul Thoulouse, l’épisode révolutionnaire est bien enterré ! Son successeur, dans les années 20, sera de nouveau Jean Serre « Pazanan ».
La restauration est une époque de grands travaux, les voies de communication s’améliorent ; Chandolas participe à ce mouvement : en 1828, construction du pont de Goularade. Le maçon local Vauclare emporte le marché en association avec le voiturier du pays Dalzon Joseph (dit Couderc car la fréquence du patronyme nécessite de différentier les diverses branches : on verra donc « ceux de Maisonneuve », les aubergistes, les « Mallet », les Couderc, ceux des « Raynauds »).
Les événements de 1830 ont peu de retentissement local, la municipalité démissionne ; en 1831 Jean-Louis Thibon « fils » (de Maisonneuve, là encore il faut différentier le patronyme) est élu maire.
En 1842, le gros problème est le choix du tracé de la route après le pont de Maisonneuve, deux tracés sont en balance (l’ancienne route bifurquait après le pont : un chemin vers Beaulieu, un autre vers Berrias, la trace de ces chemins existe encore). Le conseil municipal se réunit pour en délibérer, sont présents : Jean-Louis Thibon, maire, Jean-Baptiste Deleuze, adjoint et les conseillers : Louis Thoulouze, Joseph Vauclare, Simon Négre, Joseph Dalzon, Noé Vernède, Jean-Joseph Serre « Pazanan », Isidore Thibon qui assure le secrétariat. Le projet officiel passe par le tracé Beaulieu-Saint André, un contre-projet est présenté par l’ingénieur Lacroix d’Aubenas : par Berrias, Banne, Courry. Ce tracé a été « exhumé des archives des états du Languedoc » bien que le savant ingénieur Pommier « l’ait rejeté avec dédain », et en contestant l’emplacement du pont déjà construit : « il aurait dû être construit 400m en amont » « querelles d’experts » ! L’idée du contre-projet est d’abord de suivre une ligne droite, avec les pentes minimales mais aussi de « vivifier » 6000 habitants et d’offrir un débouché au charbon de Banne et aussi au vin de Banne (voilà déjà les lobbies de l’énergie).
Volée de bois vert du maire, il va réfuter tous les arguments de la variante ; la ligne droite, mais la distance à parcourir en plaine est équivalente dans les deux tracés. Les chiffres avancés pour la population, Berrias et Courry ne dépassent pas 2000 habitants en réalité, pour Saint Paul et Banne on ne dépasse pas 3200 ; mais à Berrias ils ont déjà la route de Pont Saint Esprit à Mende ! A Courry, la route ne passera pas dans le village et ils peuvent descendre dans la vallée de la Cèze où il y a une très belle route ! En ce qui concerne le vin de Banne : « ce vin est si abondant et si réputé qu’un canal ou même un chemin de fer serait à peine suffisant pour un pareil débouché », bref la qualité du vin de Banne est fort controversée, semble-t-il. Pour le charbon, « le magasin de la Lauze est obligé de s’approvisionner à Bessèges pour honorer ses contrats ».
Chandolas s’ approvisionne en bois de chauffage à Saint André (NDLR : tout arpent est cultivé à Chandolas ; plus de garrigue à ce moment-là) ;on appelle à la rescousse les communes voisines: la semence et le blé du Languedoc, les marchandises coloniales qui arrivent par Saint Ambroix seront plus difficiles à aller chercher pour Saint Alban et Grospierres qui devront faire le crochet jusqu’à Berrias (cela doit bien faire 2 km en plus).
On refait les comptes de population concernée à Beaulieu, Pléoux, Saint André : on trouve 9000 âmes à opposer aux 3200 de l’autre côté ; le tracé par Sauvas traverse une étendue sans habitation donc insécurité pour les voyageurs. Ceux-ci ne trouveront pas d’auberge, de maréchal ferrant, de charron, de bourreliers sur ce tracé, et puis le tracé par Sauvas est plus long, la plaine est argileuse, inondable l’hiver, le remblai coûtera cher à transporter. Les cantonniers sont stationnés à Beaulieu, avec un stock de matériaux depuis la construction du pont de Maisonneuve, tout est donc sur place à Beaulieu, le tracé par-là coutera moins cher au gouvernement.
Tout ce beau plaidoyer a été fait par le maire qui avait bien préparé sa réunion ; tous les conseillers approuvent sans piper mot, la séance est close.
Ce texte donne bonne image de la vie de l’instant et montre l’importance économique de la grande route. A Maisonneuve, on en profite, des estaminets s’installent, le maréchal ferrant monte une entreprise de « forge et charronnage » qui va employer plusieurs ouvriers. La route de Maisonneuve à Saint Alban par Chandolas est construite en 1850, la même année on décide de construire une école, cela coûtera 4000 francs, à raison de 1 franc la journée d’homme ; cette école sera bâtie en s’appuyant sur les murs de l’ancienne église et on y adjoindra un local qui servira de mairie. En effet la population augmente régulièrement, les cocons se vendent bien, on ne voit pas pourquoi cela ne continuerait, pas. La foi est restée vive, entretenue par de nombreuses missions : on construit donc une vaste église payée par souscription et participation à la construction. La crypte ancienne en dessous de la vieille église est transformée en écurie à boeufs. Le hameau qui avec la grande route a pris de l’importance s’affirme face au chef-lieu : les habitants vont à leur tour construire leur propre église et auront leur propre paroisse en 1855 (Pazanan devra y renoncer).
Les maisons se surélèvent pour abriter les magnaneries. On construit de nouvelles demeures en pierre de taille. Dès que l’on a de l’argent on barricade sa maison derrière un épais mur avec un portail monumental : résidu de la peur des brigands, des trimards, des masques armés. C’est donc à cette époque que les habitations prennent l’allure de forteresses : on vivra au moins à l’abri des regards fureteurs des voisins et on lavera son linge sale en famille.

A l’intérieur comment est-on organisé ?
La grande salle dallée de pierres de Ruoms, « les bars » qui ont remplacés la terre battue a une cheminée monumentale : la crémaillère au-dessus du foyer sert à pendre le chaudron. On cuisine sur la braise dans le fourneau de briques, le potager aménagé dans une cavité du mur ou encore sur un trépied à même le sol de la cheminée : on récupère tous les restes pour le cochon, on rince la vaisselle à l’eau chaude qui servira à faire sa pâtée. On mange dans la grande pièce, la maîtresse de maison assure le service et surveille, debout, sa maisonnée… Le mobilier rudimentaire du siècle précédent, comme la maie pour pétrir son pain, se complète par de belles armoires que l’on fait fabriquer par des compagnons de passage ou par le menuisier local.
Les parents ont une chambre. Les enfants coucheront au « pousta » l’étage auquel on accède par un escalier intérieur à vis. Ce pousta servira en mai à l’élevage des vers à soie. Les œufs de vers à soie ou « graine » sont vendus dans des boites en carton ; le « carton » sera l’unité de compte de la production à venir. On les achète à des négociants au marché de Joyeuse, ceux-ci rachèteront la production des cocons, le prix de la « graine » sera retenu à ce moment-là.
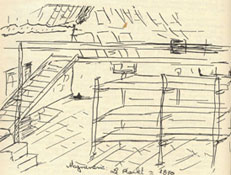

Pour faire éclore les vers, il faut de la chaleur, les femmes mettent la graine dans un sachet qu’elles rangeront au chaud dans leur corsage… Les vers éclos, on les dispose sur des tables où il faut les alimenter en feuille de mûrier en permanence. Les vers, au cours de leur croissance, subissent plusieurs mues. Chacune de ces mues s’effectue à une température bien précise qui se mesure avec un thermomètre à échelle Réaumur, car dans cette échelle la graduation correspond aux paliers requis pour chaque étape de la croissance. Cela se passe au mois de mai, il faut tenir compte des aléas de la météo : il faut coordonner la mise en production avec la croissance de la feuille de mûrier (les jeunes vers ont besoin de feuille tendre), s’il fait trop froid, il faut chauffer et s’il fait trop chaud il faut aérer sinon la production sera étouffée. Une bonne magnanerie aura un sol de brique régulant la température et beaucoup de fenêtres, si possible au nord, pour l’aération. Les vers grandissent, il faut les alimenter sans arrêt, le bruit des milliers de mandibules ressemble à une averse permanente. Puis, un jour, les plus précoces arrêtent de s’alimenter, ils se dressent en faisant tournoyer lentement leur tête : il est temps de mettre des rameaux de bruyère en place car les magnans vont s’encoconner », c’est à dire tisser le cocon qui enrobera la chrysalide. Celle-ci ne deviendra pas papillon car on va « décoconner », c’est à dire extirper chaque cocon du rameau dans lequel il s’est incrusté, on ébouillante les cocons pour tuer la chrysalide car l’éclosion du papillon briserait le cocon, le rendant impropre au filage. On vend les cocons à des négociants, mais certains s’équipent pour assurer le dévidage qui s’effectue en plein air sous des terrasses à arceaux (il faut de l’air, le dévidage libère les bestioles tuées, la puanteur est effroyable).
Mais avec le temps, des maladies apparaissent, comme la pébrine (on enverra Pasteur lui-même en mission pour trouver le traitement), on essaie donc d’injecter de la graine venant d’extrême orient.
Le journal d’un négociant en graines de Laurac, Auguste Perbost, nous donne quelques indications : en 1869, le mois de janvier a été pluvieux, en mars le grand vent de bise a été bien frais, il « aplani le Tanargue », il tombe de la neige; le mois de mai est pluvieux, la récolte des vers à soie est bonne. Le prix des cocons varie de 7 francs le kilo en début de récolte jusqu’à 6,50 en fin. Les cartons se sont vendus à très bas prix, à la foire du 25 avril on les « donne » à 25 centimes le carton, ceci est dû au fait que l’on avait importé de la graine en abondance du Japon, « on a fait le compte, il y en avait pour 5 ans ». La feuille de mûrier se vend entre 40 et 50 francs les 100 kg, on a du mal à louer des ouvriers de renfort, ils se font payer jusqu’à 5 francs par jour en période de pointe.
Les communications s’organisent, la poste s’est installée à Berrias en 1866, le facteur -à pied- a une sacrée tournée à faire ! La population augmentant, la terre ne suffit plus pour alimenter tout le monde ; certains commencent à s’expatrier : on se louera comme « gens de maison » à Paris. On ira faire le garçon de café à Marseille et parfois on revient avec un petit pécule, avec lequel on montera un petit commerce ; une boulangerie fonctionne à présent sur la place de l’église, il y a un magasin de « mode », une épicerie qui vend en fait tout le nécessaire : des sabots, des arrosoirs, du tissu. On verra s’installer des cafés.
L’événement c’est la « vote », la fête du village : nous en aurons deux, une pour Chandolas et une pour Maisonneuve. Le rituel est intangible : ce sont les jeunes de la classe qui sont responsables de l’organisation, aubade aux habitants avec la fête associée, bal, concours de tir, buvette, tir au coq vivant avec des pierres, on boit, les esprits s’échauffent, gare à la bagarre avec ceux des villages voisins ! Et puis c’est l’occasion de se rencontrer, de discuter, on parle politique, ce qui’ n’est pas vu d’un très bon œil par la gendarmerie et le clergé.
Le clergé : les curés formés au séminaire seront de « curés de choc » : on érige des croix partout; on crée des confréries, des associations d’enfants de Marie. Les processions se multiplient, l’Eglise locale encourage le maintien au pays car les ouvriers ou employés risquent de revenir avec des idées « rouges ». L’instituteur laïc commence à être un concurrent local pour le clergé.
La politique : le suffrage universel (pour les hommes), en 1848, a beaucoup de succès; les élections de 1849 voient s’établir la lutte entre « blancs et rouges », comme lors de la révolution, la gauche domine légèrement dans le canton, mais de justesse, ceci encourage les rivalités, des rixes font dégénérer les « votes ». En 1851 le département est mis en état de siège !
L’empire ramène l’ordre en supprimant les libertés politiques, avec la prospérité il pourra se permettre, vers 1860, de les rétablir sans troub1es.
Le maire désigné en 1856 est Isidore Thibon. Aux élections législatives de 1866, Joyeuse et Chandolas auront 60 % de voix à « gauche », ou républicaines comme on disait alors. L’année 1870 marque un tournant, le phylloxéra commence à apparaître et pour la première fois on a du mal à échapper à la conscription; la gendarmerie s’est renforcée, des brigades locales permettent une meilleure surveillance et information, d’autant plus que l’on emploie des gendarmes issus du pays et aussi une prime de 25 francs est offerte aux « capteurs » de déserteurs ou insoumis. Le nombre de mauvais numéros augmente, les lettres angoissées des conscrits à leurs parents appellent à l’achat d’un remplaçant avant la mise en route du régiment. Les parents cherchent mais « M.Pons, le marchand d’hommes » n’a personne sous la main, s’il trouve quelqu’un il exige une somme trop importante, il y a des rumeurs de guerre, bref il va falloir en prendre pour trois ans.

On sera (si on est bel homme) enrôlé comme cavalier dans l’armée de la Loire, ou plus souvent enrôlé dans le régiment des mobiles de l’Ardèche; pas de chance on aura droit à la campagne contre les Prussiens, puis contre l’Intérieur. Pour lutter contre la commune de Paris on faisait intervenir des régiments de province, par crainte de fraternisation; les « moblots » mettront quelques temps à réaliser qu’ on les a envoyé tirer sur des ouvriers et des artisans.
Ce n’est pas fini, les bat d’Af manquent de bras pour Pacifier l’Algérie, les étrangers manquent à la légion du même nom, on y injectera nos Ardéchois; ils y côtoieront des hommes de tous les horizons, conforteront leurs idées « républicaines », se mettront au courant du progrès…
Cependant l’empire a vécu, la république est proclamée à nouveau. En 1870, Thibon Emile est nommé président de la commission municipale de Chandolas ; des élections municipales sont organisées : une municipalité républicaine se met en place. Le maire élu est, en 1871, Auguste Dalzon. L’hiver de 1870 a été très rigoureux, la neige tombe, plus de 40 cm, elle reste longtemps ; oliviers et figuiers seront gelés. Les difficultés vont commencer, la vigne crève, il faut assumer la concurrence des soies d’orient qui arrivent à présent par le canal de Suez (les cours tombent à 4 francs au lieu de 7 francs), la pébrine ne sera guérie qu’en 1875.
Avec l’augmentation de la population et du gros bétail on manque d’eau pendant l’été, la rivière coupe, les puits ne suffisent plus. Qu’importe, on réagit, on plante des plants Américains comme le Clinton, le Jacquez et l’Herbemont, on traite les vignes par sulfatage et puis les albenassiens Couderc et Siebel inventeront des plants hybrides résistants à la maladie (on plantera abondamment de l’hybride « 7120 » qui donne en quantité une affreuse bibine sans caractère, heureusement il se marie bien avec les vins d’Algérie et le vin de consommation courante se vend beaucoup ; la quantité suppléera à la qualité).
On commence à planter la vigne dans la plaine et sur les anciennes terres à blé. On creuse des citernes dans chaque maison pour l’eau du ménage car on continue à aller chercher l’eau « pour boire » au puits, à la place, à la blachette, à l’ancien puits central : l’eau y est meilleure à boire, elle est profonde et plus fraîche. En période de sécheresse on conduit les animaux en troupeau s’abreuver à la fontaine de Pelouse, on y aménage même un abreuvoir à cet usage (une « pise »).
La vie sur les champs de cailloux devient trop dure, on commence à émigrer : on ira dans l’administration, la gendarmerie. Nos voisins se moquent de notre sol ingrat : le sobriquet des habitants c’est « gratte lauzasses » (gratte cailloux) ou encore- acampejaïres-coureurs : vont ailleurs tenter de gagner leur vie ou commerçants ? (on est dur entre communautés sur les champs de foire, les marchés et les votes: on s’interpelle pour chaque communauté avec des sobriquets pas flatteurs).


On s’organise, une corporation de négociants en bestiaux se met en place, menée par le maire elle associe plusieurs familles : on aura des « relais » en Gévaudan car on achète les bœufs de travail en Aubrac. Si besoin est, le dressage des animaux est complété et on les revend sur toutes les foires de la région et des Cévennes. Le service après-vente est assuré : on est tenu de fournir les soins nécessaires sous peine de perdre sa « réputation », en association avec le maréchal ferrant. On reprend aussi les vieilles bêtes pour la boucherie. Ce trafic nécessite beaucoup de main d’œuvre : il faut être présent sur plusieurs places en même temps, le télégraphe sert à s’informer des cours pratiqués (quasiment en « temps réel ») et à ajuster les stratégies d’achat et de vente. Il faut embaucher de la main d’œuvre pour s’occuper des bêtes achetées pendant que la foire continue, le troupeau des achats doit être ramené depuis Langogne, Aubrac, Florac : les chiens aident le meneur à guider son troupeau de halte en halte : on s’arrête dans des maisons amies, auberges, oustaus des associés locaux où l’on bivouaque pour la nuit ; le routes sont peu sûres on voyage armé de revolver et de canne ferrée ou de nerf de bœuf. Plus tard le chemin de fer sera utilisé comme moyen de transport en partant de la gare de Beaulieu-Berrias.

Toutes les transactions s’effectuent selon des contrats verbaux en suivant un rite immuable : proposition, négociation, rupture, retour et reprise de négociation et transaction « la pache » scellée par claquement des paumes « patche fate ». Il n’y aura pas de pesée, vendeur et acheteur savent « estimer » le poids de la bête à quelques kilos près. Après avoir conclu, on règle en « liquide » (le jeu c’est de compter les billets à toute allure et de compter deux fois le même, ce qui oblige l’autre à recompter…). Le maquignon marque les bêtes de coups de ciseaux rapides dans le poil (chacun a son code propre de marquage) : lorsque le vendeur traîne à se décider, l’acheteur l’incite à prendre décision en faisant mine de « marquer » la bête avec ses ciseaux. Lorsque l’affaire a été chaude on doit « payer le verre ». Le midi, « repas d’affaire », les maquignons se retrouvent à l’auberge en tenue de ville, la blouse ample bleu noir a été déposée pour le repas.
